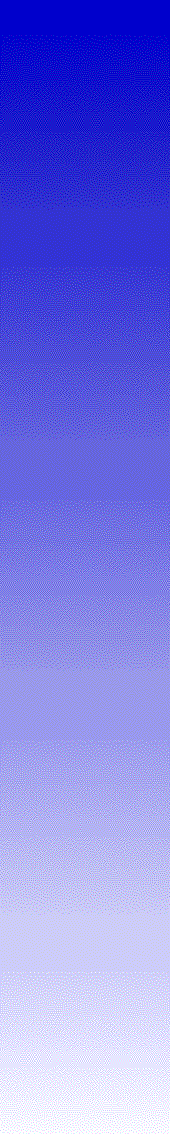UNE DISCIPLINE, UNE FORMATION,
UNE PROFESSION
UNE DISCIPLINE
Le phénomène criminel est connu de tous. Les journaux et la télévision attirent quotidiennement notre attention sur des meurtres, des vols avec violence, des affaires de femmes battues ou des trafics de drogues. Mais cette connaissance reste anecdotique. Le criminologue va au-delà du fait divers pour poser la question criminelle en toute rigueur.
Quelle est la véritable nature du crime?
Qui sont les délinquants?
Quelles sont les causes du crime?
Comment le prévenir?
Quelle est l'efficacité des mesures policières, judiciaires et pénales dans la lutte contre le crime?
La criminologie est une discipline qui se définit par son objet: d'abord le crime et ensuite la manière dont on y réagit.
Certains criminologues sont surtout intéressés par le crime lui-même. Les questions qu'ils se posent portent sur les vols et les voleurs, sur les meurtres et les meurtriers, sur les fraudes, sur le vandalisme...
Pourquoi devient-on délinquant? Pourquoi la criminalité augmente-t-elle durant certaines années et pourquoi diminue-elle durant d'autres périodes?
D'autres criminologues font porter leur attention sur la réaction de la société au crime. Ils veulent savoir pourquoi et comment certains actes en viennent à être définis comme crime.
Par exemple, pourquoi le trafic de drogue est-il un crime aujourd'hui alors qu'il n'en était pas un autrefois? Ils s'interrogent aussi sur la manière dont le code criminel est appliqué.
Enfin, ils jettent un regard critique sur le fonctionnement des organisations policières, des tribunaux criminels, des prisons et des autres mesures pénales.
La criminologie est une discipline complexe, premièrement parce qu'elle est multidisciplinaire et deuxièmement parce qu'elle est à la fois théorique et appliquée.
En tant que discipline théorique, la criminologie va chercher une bonne partie de ses informations, de ses concepts et de ses méthodes dans les sciences humaines, dans le droit, dans l'histoire et dans le philosophie. Elle puise tout particulièrement dans le sociologie, la psychologie et le droit. Ses méthodes de recherche et d'analyse s'apparentent beaucoup à la méthodologie couramment utilisée dans les sciences sociales et en psychologie. Elle est une discipline - carrefour vers laquelle convergent toutes les connaissances sur le phénomène criminel. La criminologie est aussi une discipline appliquée. La formation que le criminologue a reçue lui permet, par exemple, de décider si une libération conditionnelle peut être accordée à tel détenu ou, autre exemple, de proposer un plan d'action pour faire face à une épidémie de vols d'automobiles qui sévit dans tel parc de stationnement. Pour résoudre de tels problèmes, il faut savoir bien poser un problème criminel; il faut savoir recueillir et traiter l'information nécessaire et il faut avoir réfléchi aux enjeux éthiques et politiques que le criminologue élabore des stratégies de prévention et de gestion du risque qui tiennent compte de la dynamique du crime et de réaction sociale.
LES PRINCIPAUX CHAPITRES DE LA CRIMINOLOGIE
La criminologie clinique
C'est l'étude du délinquant comme personne dans le but de le comprendre, de prévenir sa récidive et de l'aider. Qui est le délinquant? Comment l'est-il devenu? Que deviendra-t-il? Le diagnostic criminologique a pour but de décrire le contrevenant, d'estimer les risques qu'il ne récidive puis d'élaborer un plan d'intervention approprié. La criminologie clinique étudie aussi l'intervention: le choix d'une mesure qui soit adaptée à un type particulier de délinquant, la mise en oeuvre de cette mesure et l'évaluation de son efficacité.
Les formes particulières de crime
Les crimes de violence sont fort différents des délits contre
les biens. La conduite dangereuse d'une automobile n'a pas grand chose à
voir avec l'agression sexuelle sauf que l'une et l'autre sont des transgressions
au code pénal. L'étude de la diversité de l'activité
criminelle s'impose:
- vol à l'étalage;
- cambriolage;
- vol par des employés;
- vol d'automobile;
- fraude;
- trafic de drogue;
- violence conjugale;
- homicide
Les peines, les décisions pénales et les mesures pénales
Par définition, le crime est un acte punissable. Il importe au
criminologue d'étudier les peines infligées aux délinquants.
A côté de l'incarcération et de l'amende, on trouve
aussi la surveillance dans la communauté, les travaux bénévoles
de nature compensatoires, le placemant dans un centre d'accueil et l'obligation
de réparer le dommage subi par la voctime. Comment choisit-on une
mesure pénale plutôt qu'une autre? A partir de quels critères?
En vur de quoi? Les objectifs de la sentence sont variés: intimider
la délinquant ou ses semblables, le réhabiliter, l'empêcher
de nuire, le faire payer pour son crime, etc. Ces buts sont-ils réalisés?
Est-il justifié de punir les délinquants? Ce chapitre de la
criminologie souléve de difficiles problèmes théoriques,
philosophiques et politiques.
La victimologie
Les actes criminels les plus courant lèsent les droits fondamentaux
d'êtres humaines. Le criminologue ne peut se désintéresser
de la victime. C'est pourquoi, une branche de la criminologie, appelée
victimologie, se consacre à l'étude des caractéristiques
des victimes, de l'interaction entre le criminel et sa victime, de la dynamique
de la victimisation, ses conséquences, l'aide aux victimes et la
prévention de la victimisation. Par exemple, les recherches sur les
violences faites aux femmes nous apprennent que les coups sont souvent déclenchés
par des incidents triviaux, que la femme battue est souvent socialement
isolée. Pour la plupart des crimes, il existe un rapport entre la
jeunesse et la victimisation: à partir de 25 ans, les risques d'être
victime diminuent régulièrement. Récemment, les victimologues
ont fait deux découvertes surprenantes: les victimes ont les mêmes
caractéristiques sociales et démographiques que les délinquants
et ces derniers souffrent de taux très élevés de victimisation.
La police
Le premier réflexe d'une bonne minorité de gens qui viennent
d'être victimisés est d'appeler la police. Cela signifie que
les policiers ont des contacts directs et immédiats avec la réalité
criminelle. Les services de police accumulent ainsi des information de première
main sur les crimes tout en exerçant une influence sur la criminalité.
Les criminologues ne sont que rarement des policiers: ils ne s'intéressent
pas moins à plusieurs facettes de la question policière. C'est
ainsi qu'ils étudient les décisions policières concernant
les suspects. Cette question est cruciale. En effet, le policier peut choisir
d'arrêter ou de relâcher un voleur. S'il se sent menacé,
il décidera de tirer un coup de feu ou non. Ces décisions
posent, on le voit, le grave problème de l'exercice du pouvoir discrétionnaire
du policier, pouvoir qui peut aller jusqu'à celui de donner la mort.
Les criminologues se penchent aussi sur la question de l'efficacité
de la police dans la lutte contre le crime, sur celle des objectifs de la
police et sur la mission. Cela les conduit à réfléchir
sur le rôle de la police dans la prévention du crime, sur la
police communautaire et sur la résolution stratégique des
problèmes par la police ("problem-oriented policing").
La sécurité privée
Dans les commerces et dans les grandes entreprises, c'est à une agence
de sécurité ou à un service interne de sûreté
que l'on fait appel pour prévenir le vol à l'étalage,
le vol par les employés et bien d'autres délits. Les experts
de la sécurité privée ont développé un
réel savoir-faire dans l'analyse des risques et dans la gestion de
systèmes de protection intégrés. Un rapprochement entre
la criminologie et la sécurité privée s'impose.
La prévention du crime
Les sociétés ne luttent pas contre le crime seulement par
des mesures réactives ou répressives, elles recourent aussi
à des mesures "proactives" ou préventives. Les citoyens
et les pouvoirs publics interviennent de manière non punitive pour
détourner les jeunes gens de la délinquance et pour limiter
les occasions de crime. On fait obstacle au développement de tendances
délinquantes des individus essentiellement en s'assurant que les
enfants et les adolescents qui risquent de verser dans le crime soient mieux
encadrés, mieux protégés et mieux éduqués
qu'ils ne le sont. C'est ainsi que, dans certaines écoles, les élèves
qui ont des difficultés d'apprentissage et de comportement jouissent
d'un encadrement intensif aussi bien dans leurs activités académiques
que durant leurs loisirs.
La prévention "situationnelle" procède d'une toute
autre logique. Elle repose sur le constat que les décisions délinquantes
sont influencées par les circonstances immédiates dans lesquelles
elles sont prises. Imaginons, par exemple. qu'un garçon ait envie
de voler une automobile pour "faire un tour" avec ses amis. Il
passera presque certainement à l'acte sera s'il en vient à
passer près d'une voiture sport dans laquelle se trouvent les clefs
d'allumage et il n'en fera probablement rien si tous les véhicules
qui le tentent sont protégés par de bons anti-vols. Ce type
de prévention consiste à susciter des habitudes et à
implanter des systèmes de protection qui réussiront à
persuader les délinquants potentiels que les délits envisagés
sont trop difficiles, trop risqués ou trop peu profitables.
Les débats en criminologie.
La criminologie n'est pas un champ où règne le consensus.
Certains criminologues s'efforcent de s'en tenir aux faits et ils s'interdisent
de porter des jugements de valeur; d'autres affirment qu'il faut s'engager,
prendre parti, dénoncer les injustices et les abus. Certains pensent
qu'il faut viser avant tout l'efficacité dans la lutte contre le
crime; d'autres croient que la justice prime et qu'il faut rendre à
chacun ce qui lui est dû, même quand la solution la plus juste
n'est pas la plus efficace. Certains pensent que les contrevenants sont
les victimes des circonstances et qu'il faut les traiter avec compassion,
humanité et générosité; d'autres jugent qu'il
faut faire subir aux criminels le châtiment qu'ils méritent
et leur imposer la mesure qui assurera la défense de la société.
Certains pensent qu'un droit pénal démocratique contribue
à la justice et à la sécurité du public tout
en garantissant les droits et les libertés; d'autres pensent que
le système pénal produit plus de souffrance qu'il n'en épargne
et qu'il faut trouver une réponse plus civilisée à
la question criminelle. Dans la communauté des criminologues, cette
diversité d'opinions alimente une controverse qui est à l'image
du débat qui renaît sans cesse dans les sociétés
démocratiques autour des choix se politiques sociales et pénales.
Bien que la criminologie n'échappe pas à la controverse, elle
reste un savoir rigoureux sur le criminel, sur le crime, sur la criminalité,
sur les peines, sur la victime, sur la sécurité privée,
sur la police et sur la prévention. Ce savoir peut servir à
tous ceux qui veulent apporter une contribution à la solution du
problème criminel: agents de probation ou de libération conditionnelle,
policiers, conseillers en sûreté industrielle, administrateurs
dans les prisons et dans les pénitenciers, travailleurs sociaux,
avocats, juges, etc.
UNE PROFESSION
Les secteurs dans lesquels travaillent les criminologues sont étonnamment diversifiés et nombreux: prisons et pénitenciers, libération conditionnelle et probation, centres d'accueil de réadaptation et centres de protection de l'enfance et de la jeunesse, foyers de groupe pour les jeunes toxicomanes et maisons de transition pour les ex-détenus, centres d'aide aux victimes d'actes criminels, ministères, services de police, municipalités... Dans tous ces milieux, les criminologues déploient une activité aux facettes multiples: l'intervention clinique, la gestion de programmes, l'animation, la consultation, l'analyse, la recherche, l'enseignement...
L'INTERVENTION AUPRÈS DES DÉLINQUANTS ADULTES
La détention
Dans les milieux de détention, les criminologues ont la responsabilité
d'évaluer les délinquants au début de leur séjour.
Ils font un bilan de leur histoire sociale et familiale, ils analysent leurs
conduites criminelles (les motifs, les circonstances, la gravité
des délits et la nature des récidives). L'évaluation
permettra d'orienter les détenus vers des programmes appropriés
à leurs besoins sans pour autant menacer la sécurité
du public: formation académique, travail, thérapie dans un
établissement à sécurité minimale, moyenne ou
maximale.
Le travail du criminologique en milieu carcéral comporte aussi le
support aux détenus pour les aider à purger leur sentence
dans la perspective d'un retour éventuel dans la société.
Les criminologues auront également à évaluer la capacité
d'un détenu à bien fonctionner lors d'une libération
éventuelle.
La libération conditionnelle et les maisons de transition
Les criminologues agissent aussi auprès de ceux qui bénéficient
des programmes de mise en liberté sous condition après avoir
purgé leur sentence. Ils sont également présents dans
les maisons de transition qui accueillent les ex-détenus dans le
cadre d'absences temporaires, de programmes de semi-liberté ou de
la libération conditionnelle totale. Leur rôle est d'assister
et de surveiller l'ex-détenu dans ses efforts de réinsertion
sociale. Les criminologues doivent aussi veiller à ce que les personnes
sous leur surveillance se conforment aux lois et qu'elles s'acquittent de
leurs engagements. Lorsque la personne en liberté surveillée
risque de récidiver, ne respecte pas ses engagements, ou commet de
nouveaux délits, le criminologue doit agir dans l'intérêt
de la société. Il peut alors être appelé à
recommander des mesures, pouvant aller jusqu'à la réincarcération.
Les mesures pénales non carcérales
Les criminologues travaillent également auprès de contrevenants
adultes condamnés à des sentences autres que la détention,
notamment dans le cadre de mesures probatoires ou de travaux communautaires.
Ces peines sont purgées dans la communauté, mais elles n'en
sont pas moins assorties de conditions à respecter. On peut y retrouver,
par exemple l'obligation d'aviser son agent lors d'un déménagement,
de se rapporter régulièrement à la police ou encore
de suivre un traitement pour sa toxicomanie. Dans le cas des travaux communautaires,
le contrevenant aura à effectuer du travail bénévole
dans divers organismes (par exemple, dans un centre pour handicapés
ou dans un service de loisirs pour les jeunes).
L'INTERVENTION AUPRÈS DES JEUNES
Les criminologues interviennent aussi auprès des jeunes qui commettent des délits et auprès de ceux que la société doit protéger parce qu'ils sont gravement négligés, ou victimes d'abus ou encore parce que les parents se déclarent impuissants devant leurs troubles de comportement. Ces professionnels sont engagés par les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse, par les centres de réadaptation, par les maisons d'hébergement ou par les foyers de groupe.
Les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse
Dans les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse, la plupart
des criminologues travaillent auprès des jeunes contrevenants. Outre
les délits qu'ils commettent, ces derniers sont souvent en conflit
avec les parents; ils ont des difficultés scolaires et il leur arrive
de consommer de la drogue. Ces jeunes ont des besoins d'encadrement et de
support. Ils auront à se conformer à une ordonnance de probation
décidée par le tribunal de la jeunesse, à effectuer
des travaux communautaires, à participer à des rencontres
de conciliation avec les victimes, à payer une amende ou encore à
être placés en famille d'accueil. Les criminologues seront
appelés à évaluer les adolescents qui font l'objet
d'une de ces mesures et à les orienter vers des services adaptés
à leurs besoins.
Dans les centres de protection de l'enfance et de la jeunesse, les criminologues
font aussi partie des équipes qui assurent la prise en charge des
enfants en situation de protection. Délégués par le
Directeur de la protection de la jeunesse, ils ont à intervenir lorsque
les parents n'assument pas leurs responsabilités, que les droits
de l'enfant sont lésés ou que sa sécurité ou
son développement est compromis. Dans un tel contexte, les criminologues
peuvent être amenés à recommander au juge l'application
de mesures telles que le retrait de certains droits parentaux ou un placement
en centre d'accueil. Évaluer la situation familiale, mettre en place
des moyens pour que cessent les comportements abusifs, impliquer les parents
et les amener à mieux assumer leurs responsabilités, répondre
aux besoins de l'enfant, ce sont là des tâches auxquelles ils
vont se consacrer.
Les centres d'accueil de réadaptation
Un certain nombre de criminologues sont également embauchés
comme éducateurs auprès des adolescents qui sont placés
dans les centres d'accueil de réadaptation. Ces criminologues-éducateurs
assument une présence continue auprès des jeunes dans leurs
activités quotidiennes: repas, travaux scolaires, ateliers de travail,
loisirs, etc. Ces moments de vie sont utilisés pour aider les jeunes
à prendre conscience de leurs difficultés, à développer
des liens plus positifs avec autrui et à contrôler leurs comportements.
Les ressources communautaires
Les foyers de groupe et les maisons d'hébergement pour les jeunes
recrutent aussi des criminologues.
Ces établissements se distinguent des prisons ou des centres d'accueil
par leur insertion dans le tissu urbain et par la relative liberté
dont jouissent ceux qu'ils abritent. Outre la délinquance, les adolescents
et les jeunes adultes qu'ils accueillent sont aux prises avec des problèmes
d'adaptation très divers: isolement social, drogue ou alcoolisme,
itinérance, tendances suicidaires, abandon scolaire, etc. Les criminologues
vont leur offrir une assistance dans la recherche d'emploi ou d'un logement;
ils vont les référer à un thérapeute; ils vont
servir d'intermédiaires entre le jeune et sa famille ou son école.
Les objectifs poursuivis sont alors d'éviter de nouveaux placements,
de prévenir la récidive, d'intégrer dans la société
et de rendre autonome.
L'ASSISTANCE AUX VICTIMES
L'assistance auprès des victimes d'actes criminels a connu un essor certain au cours des dix dernières années. Diverses ressources ont été mises en place afin de venir en aide aux victimes et à leurs proches: centres d'aide, maisons d'hébergement pour les femmes et enfants victimes de violence familiale, services d'indemnisation. Des criminologues oeuvrent au sein de ces organismes. Ils informent, accompagnent et aident des victimes de crimes très divers: abus sexuel des enfants et des adultes, négligence des personnes âgées, violence intrafamiliale, homicide d'un proche...
LA PRÉVENTION DU CRIME
Le criminologue qui agit comme conseiller en prévention dans une
municipalités, dans un service de police ou dans une école
a un triple rôle: information, animation et consultation. Dans sa
mission d'information, il diffuse des connaissances sur les risques de victimisation,
sur les habitudes à prendre pour se protéger contre le crime
et sur les systèmes de sécurité.
Dans sa mission d'animateur, le criminologue organise des rencontres entre
policiers, citoyens, commerçants, administrateurs et fonctionnaires
dans le but de susciter une action concertée contre le crime. Il
met les citoyens en rapport les uns avec les autres pour développer
la solidarité et la cohésion dans les quartiers.
Dans son rôle de consultant, le criminologue analyse les situations
à risque et il propose diverses mesures pouvant faire baisser la
probabilité de victimisation. C'est ainsi qu'il visite les domiciles,
les commerces ou tout autre établissement exposé au crime
pour connaitre les points faibles des systèmes de protection contre
le vol et pour proposer des solutions préventives très diverses:
surveil-lance, obstacles matériels, aménagement des lieux,
etc.
L'ANALYSE CRIMINOLOGIQUE
Les solutions préventives ne valent que si elles sont fondées
sur une connaissance préalable du problème posé et
de son contexte. De la même manière, l'amélioration
du fonctionnement interne d'une prison, d'une maison de transition ou d'un
bureau de probation exige une analyse préalable de la situation et
des problèmes qui s'y posent. Voilà ce qui justifie l'analyse
criminologique. Elle répond à un besoin de connaissances spécifiques
et rigoureuses des problèmes et de leurs contextes afin de proposer
des solution concrètes qui vont réduire la fréquence
d'une forme particulière de crime ou favoriser une gestion plus saine
et plus humaine des programmes. Dans ce qui suit, on donnera quelques exemples
de projets d'analyse criminologique.
Un criminologue a reçu comme mission d'étudier l'ampleur,
les caractéristiques et les causes des fraudes par cartes de crédits
afin de découvrir les moyens de prévenir et de réprimer
ce délit.
Constatant que la situation des victimes au palais de justice est déplorable,
une criminologue a réalisé une analyse de leurs besoins puis
a fait aux autorités judiciaires des recommandations incitant les
avocats à traiter les victimes avec plus d'égard. Elle a aussi
contribué à la mise sur pied de programmes d'information,
et d'aide pour les victimes qui doivent témoigner lors d'un procès.
Confronté à un problème de surpopulation dans les prison
provinciales, un ministre a confié à un comité présidé
par un criminologue le mandat d'analyser le problème et de faire
des suggestions sur les manières de développer les mesures
de rechange à l'emprisonnement.
Dans leur rôle d'analyste, les criminologues sont souvent indispensables
lors de l'élaboration et de la planification des politiques criminelles.
On les retrouve au sein des ministères fédéraux et
provinciaux tels que ceux de la Justice, du Solliciteur général
du Canada, de la Sécurité publique ou de la Santé et
des services sociaux. Ils sont aussi présents dans les corps policiers
ainsi que dans des organismes comme la Société de criminologie
et l'Association des services de réhabilitation sociale.
LA RECHERCHE ET L'ÉLABORATION DES POLITIQUES
La recherche a toujours été un champ d'action important
en criminologie. Comprendre ce qui favorise la commission d'un crime, étudier
les caractéristiques particulières de certains types de délinquants,
examiner l'effet des sentences sont des questions qui on fait l'objet de
travaux très rigoureux. Les exemples de recherches abondent: étude
sur le vol à main armée, recherches sur la prise de décision
qui conduit aux choix d'une peine, sur la personnalité des délinquants
récidivistes et sur ce qui les distingue des non-délinquants,
étude da la récidive des détenus en libération
conditionnelle, évaluation de l'efficacité de traitements
pour délinquants toxicomanes.
Ces différentes activités de recherche contribuent à
la connaissance du phénomène criminel, du contrôle social
et des moyens qui permettraient de faire face au crime de la manière
la plus efficace et la plus humaine possible.
On trouve aussi des criminologues qui travaillent à l'élaboration
des politiques sociales et pénales. Ils étudient l'impact
des lois criminelles et proposent des amendements. Ils conçoivent
des programmes spéciaux pour les délinquants ou pour les victimes.
Ils contribuent à la réforme des systèmes de choix
de la peine et de gestion des mesures pénales.
LA DIRECTION ET LA GESTION
Ayant acquis de l'expérience, de nombreux criminologues en viennent à occuper des postes de gestion et de responsabilité. Ils deviennent directeur de prison, directeur des services professionnels en centre d'accueil, directeur d'un service de probation, responsable d'une maison de transition, coordonnateur d'in centre d'aide aux victimes d'actes criminels, responsable des ressources humaines dans un centre de services sociaux. Outre les tâches habituelles d'un gestionnaire, comme le recrutement, la planification, la direction du personnel et le contrôle de la qualité des services à la clientèle, le criminologue qui accède à un poste de responsabilité doit garder à l'esprit les préoccupations qui lui sont propres: protection de la société, justice, réhabilitation, humanisation...
LES AUTRES MÉTIERS
Les criminologues sont également présents dans un hôpital psychiatrique sécuritaire comme l'Institut Philippe Pinel, dans les ressources pour les toxicomanes, à l'emploi d'entreprises bancaires, dans les compagnies d'assurance et dans l'enseignement collégial et universitaire.